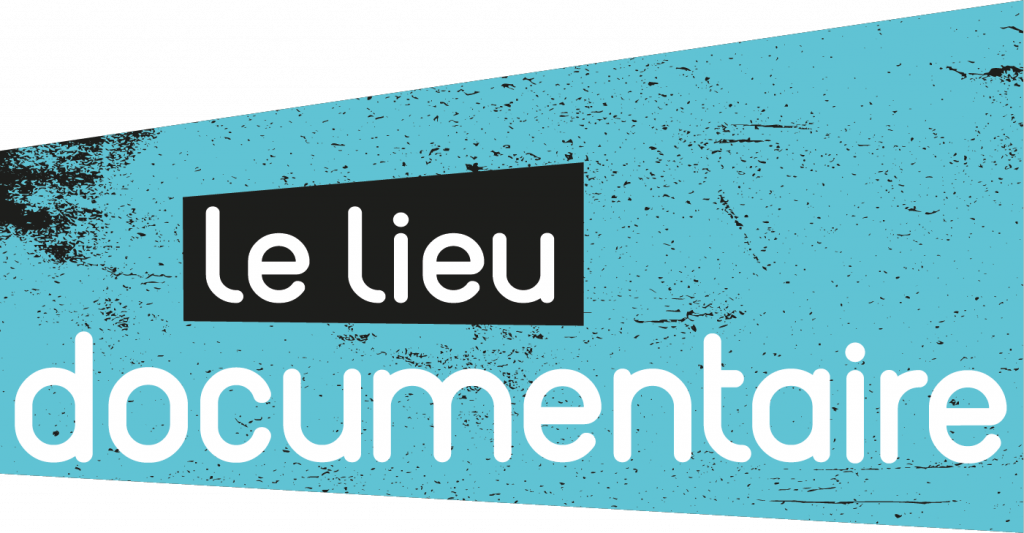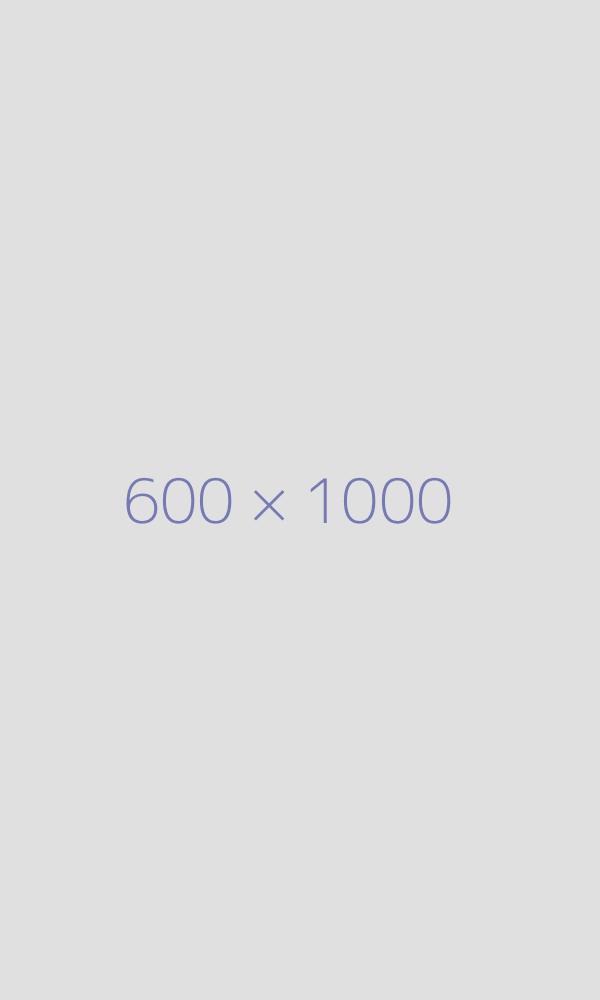Une caméra Super-8, un ex-voto et une photo prise huit ans plus tôt sont les viatiques du dialogue engagé par Laetitia Mikles avec la cinéaste japonaise Naomi Kawase, qu’elle rencontre chez elle, à Nara, dans cet environnement dont on comprend vite qu’il fournit à ses films leur matière/matrice principale. Pour preuve, de nombreux extraits, des premiers essais autobiographiques aux longs métrages de fictions Suzaku (1997) ou Shara (2003).
La famille et son absence hantent les œuvres de Naomi Kawase, depuis l’inaugural Ni tsutsumarete (1992) jusqu’à La Forêt de Mogari (2007). Cette thématique trouve bien entendu sa source dans l’autobiographie : un père inconnu et une mère absente, dont Kawase n’est parvenue à retracer l’existence que dans le geste cinématographique même. C’est pourquoi ses films échappent à une certaine forme de complaisance : le cinéma n’est pas un mode d’auto-apitoiement, mais l’outil privilégié de son appréhension du monde. De même dans Rien ne s’efface : le témoignage autobiographique cède le pas immédiatement à une théorie du cinéma comme mode d’inscription du souvenir, et surtout comme moyen d’assurer, face au temps, l’existence des choses et de soi. On y verrait peut-être une fétichisation un peu naïve des pouvoirs d’enregistrement de la caméra, si œuvre et discours ne reposaient au contraire sur la dialectique fondamentale du hasard et du fabriqué, de l’existant et de l’imaginé.
(Mathieu Capel)