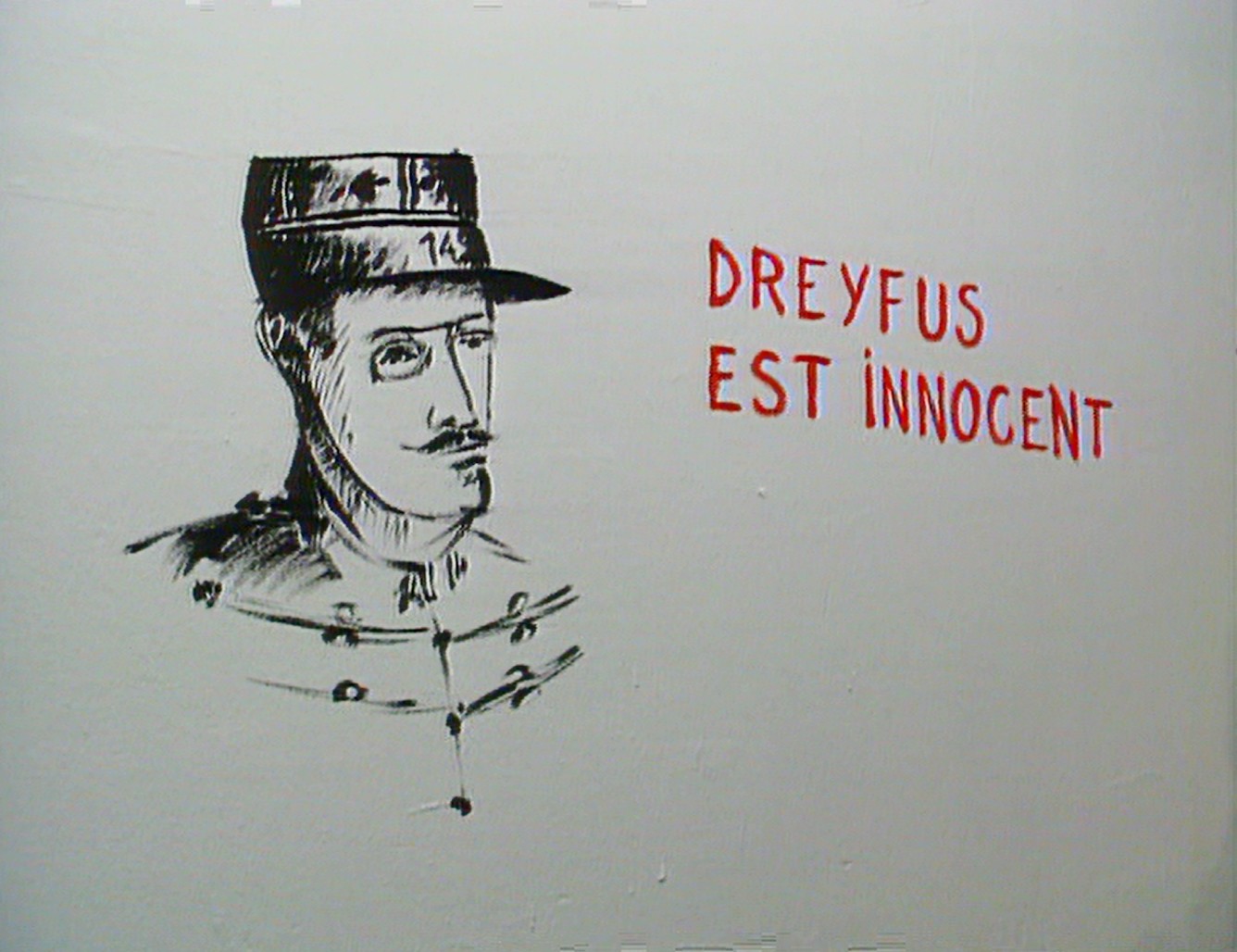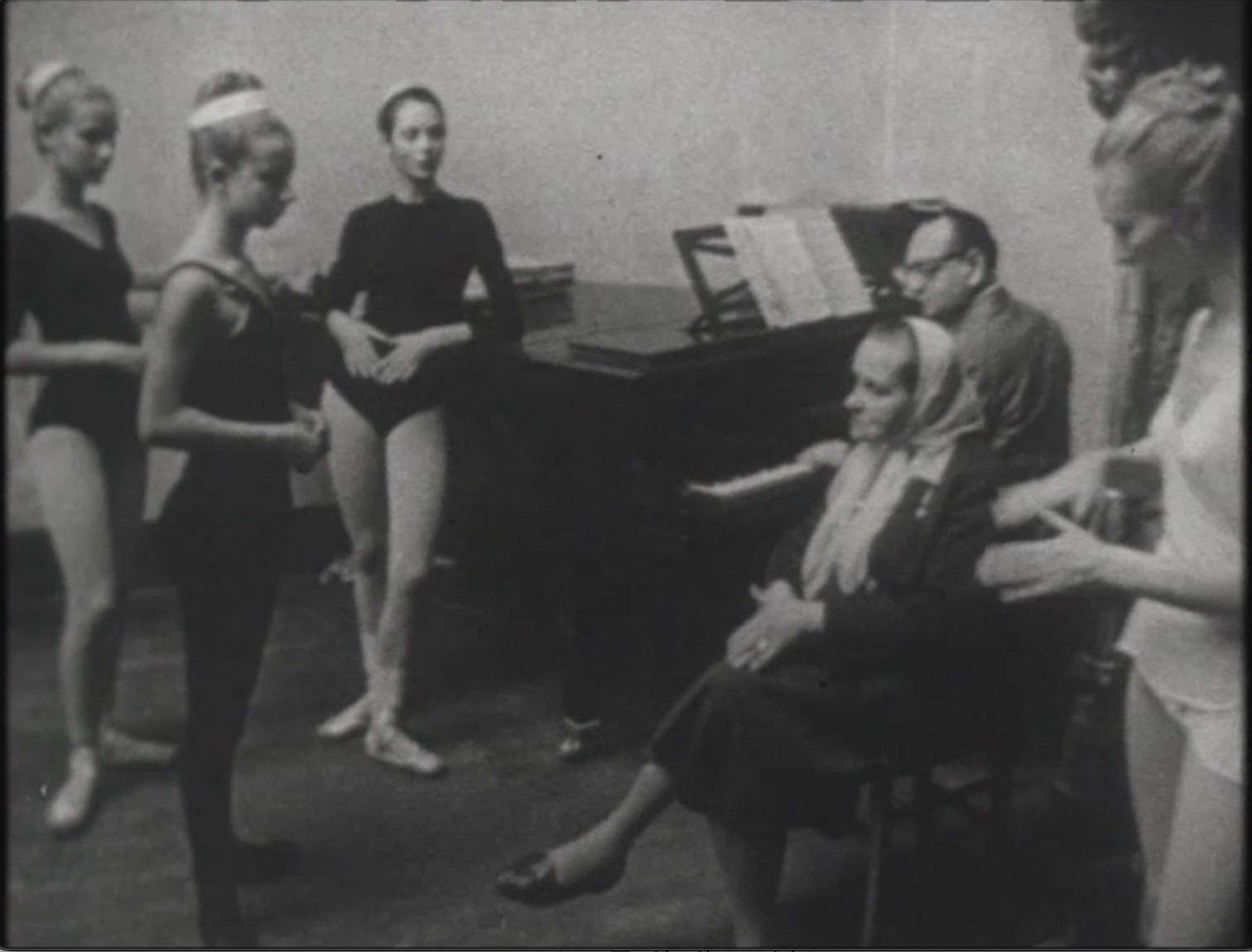En allant interroger chez eux ses pairs – Genssous, Tarta, Roy, Krier, Bringuier, Drot, Bluwal – et à l’appui de nombreux extraits d’émissions de l’époque, Raoul Sangla évoque la genèse de la télévision française. Les évolutions techniques, la liberté et l’engouement pour ce nouvel outil ont permis alors à une poignée de jeunes réalisateurs d’inventer un autre langage que celui du cinéma.
La devise de la Radio Télévision Française était en ce temps « Informer, cultiver et distraire ». Une mission de « maison de la culture hertzienne », pour ces réalisateurs audacieux et humanistes qui l’ont inventée. Avec des caméras de plus en plus légères et autonomes, ils se sont approprié un nouveau genre purement télévisuel : le direct. Que ce soit pour des documentaires, des fictions ou un événement tel que l’exploration du gouffre de la Pierre-Saint-Martin, le direct rompait soudain avec les habitudes du cinéma. « Ils ont exploré toutes les possibilités de l’outil » explique Gilles Delavaud, auteur de L’Art de la télévision, 1950-1965. La vision multiple de trois ou quatre caméras ou le regard qui s’adresse à l’objectif ont défini un style et une esthétique que le téléspectateur devait apprendre à décrypter. « On créait un instrument qui n’avait pas de précédent » souligne Alexandre Tarta, et Jacques Krier d’ajouter : « C’était une aventure prodigieuse ! »
(Caroline Terrée)