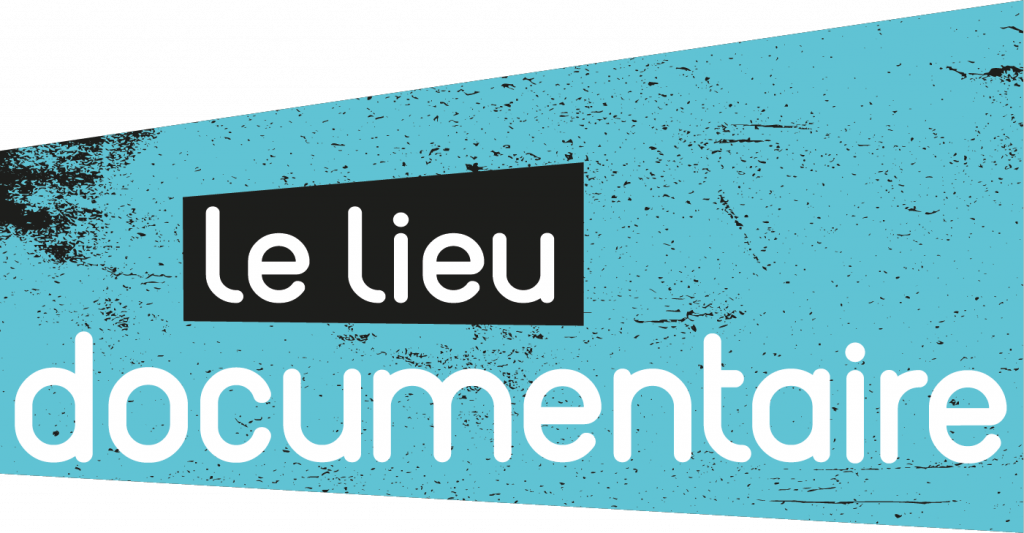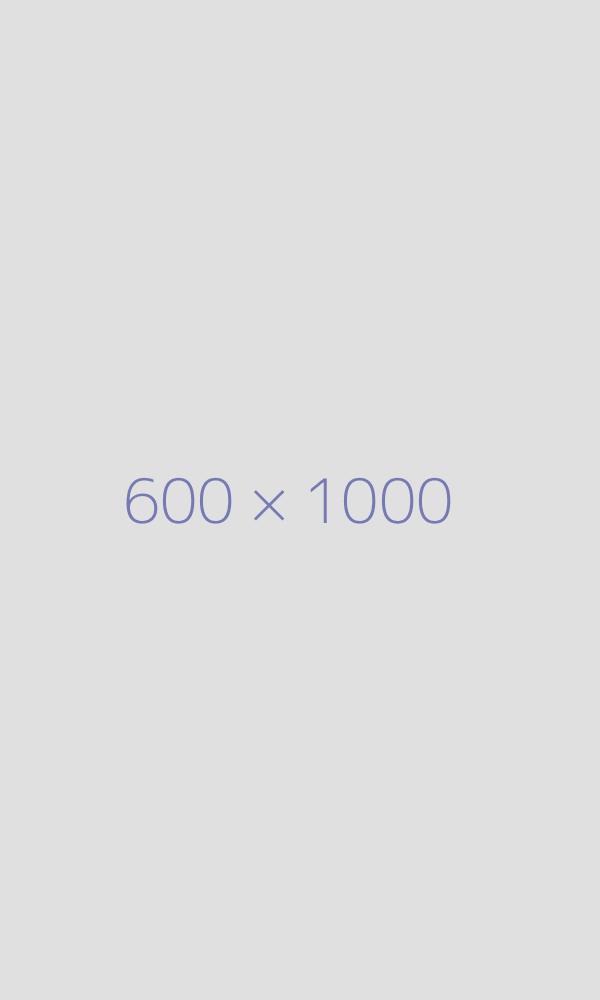C’est à la complicité entre le plasticien Robert Rauschenberg et Billy Klüver, ingénieur de la compagnie de téléphone Bell, que l’on doit 9 Evenings : Theatre & Engineering, un ensemble de performances présentées dans le grand bâtiment de l’Arsenal du 69e Régiment de New York, en octobre 1966. Le concept était simple : permettre à une dizaine d’artistes de réaliser la performance de leur rêve, grâce à la technologie des laboratoires Bell. Nées des expérimentations des membres de la compagnie de Merce Cunningham et du Judson Dance Theatre, les 9 Evenings marquent une étape décisive dans l’évolution des rapports entre l’art et la technologie. Soir après soir, projecteurs, caméras vidéo, transistors, amplificateurs, électrodes et oscilloscopes firent leur entrée sur scène au service de visions ambitieuses, futuristes, iconoclastes et poétiques – qui toutes furent filmées en noir et blanc et en couleur. Lorsque ces films furent retrouvés en 1995, Billy Klüver décida, en collaboration avec Julie Martin et la réalisatrice Barbro Schultz Lundestam, de produire une série de documentaires restituant ce qui s’était produit sur le plateau et lors de la préparation des performances. Ainsi le matériau original fut-il complété par des entretiens avec les protagonistes de chaque performance (artistes et ingénieurs) et quelques invités prestigieux. Les 9 Evenings allaient pouvoir retrouver leur place dans l’histoire de l’art.
John Cage, Variations VII (2007)
Variations VII, performance électroacoustique de John Cage, fut présentée les 15 et 16 octobre 1966. Dans la droite ligne de sa philosophie musicale, on y voit le compositeur, assisté d’une équipe d’ingénieurs et de musiciens, mélanger en temps réel des sons transmis de la ville et le bruit d’ustensiles quotidiens, le tout provoquant une incroyable masse sonore.
Comparée au grondement des chutes du Niagara par l’artiste Nam June Paik présent lors de la soirée, Variations VII est tenue pour l’une des plus belles pièces électroniques de John Cage, qui, selon son habitude, compose avec toutes sortes de bruits parasites un immense poème musical : le son des transistors, ventilateurs, grille-pain et autres instruments ménagers est ici mixé avec ceux de différents lieux de New York reliés par téléphone : le bocal à tortue de Terry Riley, les rotatives de l’imprimerie du New York Times, le studio de Merce Cunningham, une salle de restaurant… Serrés derrière deux tables jonchées d’amplificateurs et de câbles, éclairés par des projecteurs posés à même le sol, un groupe d’opérateurs, tels des serveurs derrière un bar, actionnent des modulateurs, branchent et débranchent des micros sous le regard médusé du public, tandis que roulent et retentissent dans les hauteurs de l’Arsenal les déflagrations de cette symphonie concrète entièrement improvisée.
Lucinda Childs, Vehicle (2010)
Présentée les 16 et 23 octobre 1966, Vehicle est une performance musicale et chorégraphique de Lucinda Childs mettant en scène trois danseurs, un système de mobiles et de projecteurs, un émetteur à ultrasons et une cabine sur coussin d’air. Réminiscence des machines lumineuses du Bauhaus, ce dispositif repose sur la création du son par le mouvement.
Disciple de Merce Cunningham, Robert Rauschenberg et John Cage, Lucinda Childs participe au Judson Dance Theater dans les années 1960. En 1976, elle sera chorégraphe et interprète d’Einstein on the Beach de Bob Wilson et Philip Glass. Fascinée par l’interaction entre le corps et les objets, et par la manière dont un danseur peut produire sa propre musique par ses mouvements, l’artiste voit dans Vehicle une occasion inédite de travailler avec des moyens technologiques d’envergure. Avec les ingénieurs des laboratoires Bell, elle conçoit une œuvre aux formes géométriques autour de la transmission de signaux sonores et lumineux. Les performeurs agissent ici plus comme des opérateurs que comme de véritables danseurs. Isolé dans une cabine de plexiglas, Alex Hay remet trois seaux illuminés à William Davis qui les suspend à une charpente. Lucinda Childs impulse et contrôle leur balancement qui fait varier les fréquences d’un faisceau d’ultrasons, ainsi que les ombres qu’ils projettent.
Öyvind Fahlström, Kisses Sweeter than Wine (1996)
Présentée les 21 et 22 octobre 1966, Kisses Sweeter than Wine est une performance théâtrale d’Öyvind Fahlström qui propose une critique aussi radicale qu’extravagante de l’idéologie du bonheur défendue par la société américaine. La technologie des ingénieurs de Bell est ici mise au service d’une machine de scène explosive dont l’artiste est le Monsieur Loyal.
Si Öyvind Fahlström saute sur l’occasion qui lui est donnée de travailler avec les ingénieurs de Bell, c’est moins pour mettre en avant une esthétique futuriste que pour concevoir un spectacle à la démesure de son imagination. Parade de cirque, personnages descendant des cintres, projections multiples, les allégories défilent : un homme-grenouille percé d’une flèche, un homme au corps qui fume, une tête géante de Lyndon B. Johnson, d’étranges insectes qui se balancent des chiffres épinglés sur le dos… Sur fond de guerre du Vietnam, de militantisme et de contre-culture, Fahlström se livre à une satire acerbe de la poursuite du bonheur. La technologie elle-même n’est pas épargnée : films de science-fiction, images d’actualité et bandes dessinées dénoncent sa complicité avec la guerre et le pouvoir. Et tandis que Robert Rauschenberg déguisé en Jedediah Buxton, un génie mathématique du XVIIIe siècle, résout des calculs impossibles, d’autres se livrent à des batailles de polochon.
Alex Hay, Grass Field (2008)
Grass Field fut présentée les 13 et 22 octobre 1966. Cette performance d’Alex Hay relève à la fois du dispositif scénographique et de l’expérience scientifique. Couvert d’électrodes qui amplifient les sons les plus intimes de son corps, assis devant un grand écran sur lequel apparaît son visage, l’artiste repousse les limites perceptibles de l’individu.
Grass Field (un champ d’herbe) c’est sans doute ce que sont censés représenter les 24 carrés de tissu numérotés qu’Alex Hay dispose sur le plateau en ouverture. Ce territoire sera ensuite défait par deux agents munis de perches, Robert Rauschenberg et Steve Paxton, tandis que le performeur se tient assis immobile au milieu de la scène. Sans doute en vertu d’un jeu de mots (hay signifie foin) ce champ d’herbes désigne-t-il le territoire intime de l’artiste, d’abord délimité, puis défait, au fur et à mesure que les fréquences de son corps emplissent la salle et que les détails de son visage halluciné imprègnent le regard du spectateur. S’exposer ainsi, être confronté aux sons filtrants à travers sa peau tout en restant longuement immobile se révéla une épreuve pour le plasticien-danseur. La technologie, utilisée de manière ludique dans les autres performances, devient ici l’instrument d’une expérience inquiétante. Une forme de science-fiction dont l’artiste est le cobaye.
Deborah Hay, Solo (2012)
Solo de Deborah Hay, représenté les 13 et 23 octobre 1966, n’est pas à proprement parler un solo mais une pièce chorégraphique pour 16 danseurs, 8 plate-formes téléguidées et leurs opérateurs. Chaque danseur semble toutefois suivre une déambulation solitaire qui ne rencontre qu’épisodiquement celle des autres, quand il n’est pas isolé sur une plate-forme.
C’est un voyage au Japon, effectué lors d’une tournée avec la compagnie de Merce Cunningham, qui est à l’origine de cette performance. Impressionnée par le théâtre nô, Deborah Hay voulut intégrer à son travail la lenteur, la simplicité, la suspension propres à la tradition japonaise. La danseuse, qui a régulièrement collaboré avec Steve Paxton, Robert Rauschenberg et son époux Alex Hay, offre ici une des pièces les plus dépouillées des 9 Evenings. Mais son minimalisme n’est pas dénué d’humour. En bordure de piste, un chef d’orchestre dirige les opérateurs chargés de piloter les plate-formes sur lesquelles les danseurs se dressent ou s’affalent. Assis sous des antennes géantes, ces opérateurs ont l’air de dactylos impassibles. Les danseurs, eux, semblent former une nébuleuse d’atomes à la trajectoire hésitante. Leur économie de mouvement atteint son paroxysme lorsque ce sont les plate-formes qui les baladent à travers la scène, dignes comme des Apollon ou raides comme des planches.
Steve Paxton, Physical Things (2013)
Les 13 et 19 octobre 1966, Steve Paxton investit la grande salle de l’Arsenal avec une gigantesque structure gonflable en polyéthylène : un ensemble composé de longs tunnels, d’une salle et d’une tour, à travers lesquels les spectateurs sont invités à se déplacer. Équipé d’une petite radio de poche, chacun peut saisir les ondes d’une bande sonore composée par Robert Ashley.
Cette œuvre participative est apparue à Steve Paxton dans son sommeil. Elle marque l’apogée et la fin d’une série de performances réalisées par l’artiste avec des structures gonflables. L’idée chère au Judson Dance Theater de repousser la limite entre danseurs et non-danseurs atteint ici une forme radicale, puisque la place entière est laissée au public, libre de déambuler à travers un environnement conçu par le chorégraphe. Ce dédale de boyaux synthétiques, intitulé Physical Things, propose toutefois une série d’expériences qui ont un rapport avec le corps et sa perception intime. En certains points du parcours émergent de la foule des visions anatomiques : une jeune femme couverte de cristaux liquides, colorés par sa circulation sanguine, des morceaux de chair en mouvement isolés par un voile noir, des jumeaux observant les passants. Tandis que dans la tour le public est exposé à un bourdonnement continu, dans la salle sont projetées sur un arbre artificiel des images de la nature.
Yvonne Rainer, Carriage Discreteness (2008)
Présentée les 15 et 21 octobre 1966, Carriage Discreteness est une performance chorégraphique d’Yvonne Rainer, qui juxtapose différents éléments livrés à l’interprétation du public : le déplacement d’objets et de personnes au niveau du plateau, la gravitation de mobiles dans les hauteurs, une conversation à propos d’un film et des projections sur écran.
Cette ambitieuse performance combine l’intérêt grandissant de la danseuse Yvonne Rainer pour le cinéma et les recherches du Judson Dance Theater sur les gestes issus du quotidien. Deux plans semblent s’opposer selon un réseau complexe de correspondances et significations. Un plan profane : celui du plateau où un groupe de danseurs déplace des plaques et des poutres (sculptures empruntées à Carl Andre) à la manière d’ouvriers ou de déménageurs. En fond sonore, la conversation d’un homme et d’une femme à propos d’un film de Bertolucci. Et un plan céleste : celui d’objets circulant sous la voûte de l’Arsenal, une tige et une sphère, tels des satellites ou des divinités abstraites. Parmi eux, Steve Paxton, ange acrobate propulsé du balcon, fend l’espace sur une balançoire jusqu’à s’immobiliser progressivement au-dessus du plateau. Une référence au cirque que l’on retrouve dans l’extrait d’un film de W.C. Fields, auquel succède une séquence tirée d’un mélodrame avec James Cagney.
Robert Rauschenberg, Open Score (1997)
Open Score est une performance théâtrale de Robert Rauschenberg qui fut donnée les 14 et 23 octobre 1966. Elle s’ouvre sur un match de tennis entre un homme et une femme, dont le bruit des balles heurtant les raquettes est amplifié. Peu à peu le couple plonge dans l’obscurité, laissant apparaître une foule fantomatique projetée sur trois écrans suspendus au-dessus du public.
Des dix performances données dans le cadre des 9 Evenings, celle de Robert Rauschenberg est l’une des plus épurées. A l’instar de Kisses Sweeter than Wine d’Öyvind Falhström, elle ne met pas en avant l’attirail technologique mis au service des artistes par les ingénieurs de la société Bell, mais propose un dispositif scénique dans lequel la technique s’efface derrière la composition d’énigmatiques tableaux. Rien ne laisse deviner les émetteurs cachés dans les manches des raquettes, ni la caméra infrarouge, première en son genre, qui restitue l’image d’une foule cachée dans l’obscurité tout en la nimbant d’une étrange pâleur. Que la technique soit invisible confère à Open Score, métaphore ouverte laissée à l’interprétation du public, une dimension magique voire fantastique ou mystique. Rauschenberg y ajoutera une coda le second soir : un corps de femme emmailloté (Simone Forti) chantant une complainte italienne, que l’artiste déplace dans ses bras en différents points de la scène.
David Tudor, Bandoneon ! (2009)
Les 14 et 18 octobre 1966, David Tudor, qui fait partie avec John Cage et Gordon Mumma du pool de compositeurs de la compagnie de danse de Merce Cunningham, transforme la voûte de l’Arsenal du 69e Régiment de New York en immense caisse de résonance. Une expérience électroacoustique haletante et chaotique, conduite par les soufflets d’un bandonéon connecté à un réseau d’amplificateurs.
Avec Variations VII de John Cage, Bandoneon ! est la seconde pièce électroacoustique présentée lors des 9 Evenings. Comme Cage, David Tudor était déjà familier des bricolages électroniques. Le documentaire qui succède à la performance revient sur ses premières expérimentations sous l’influence de Gordon Mumma. Comme Cage, Tudor eut à composer avec l’écho extraordinaire répercuté par la voûte de l’Arsenal. Mais à la différence de son collaborateur, Tudor ne fonde pas sa performance sur l’orchestration de sonorités tirées du quotidien, mais sur l’exploration des possibilités inédites d’un instrument de musique traditionnel. Formé à la pratique de l’orgue, David Tudor s’est ingénié à manipuler la masse sonore répercutée par l’architecture de l’Arsenal à partir d’un bandonéon savamment amplifié et d’autres modules de son invention. Une masse sonore dont on pouvait observer les variations frénétiques sur l’écran d’un oscilloscope, à la manière des drippings de Jackson Pollock.
Robert Whitman, Two Holes of Water-3 (2013)
Two Holes of Water-3 de Robert Whitman fut présenté les 18 et 19 octobre 1966. Dans cette variation sur le drive-in, sept voitures venues se garer sur le plateau projettent différentes séquences tout autour de la scène : documentaires animaliers, programmes de télévision, films réalisés par l’artiste ou tournés en direct depuis le balcon de la salle. Robert Whitman a mis à profit l’invitation de Billy Klüver pour élaborer un dispositif spectaculaire qui tient à la fois du théâtre et de l’installation.
Comme dans Open Score de Robert Rauschenberg, la vision de l’artiste assimile la technologie de pointe et la fait passer au second plan. A mi-chemin entre le pop art et la philosophie de Cage, qui veut que l’art se nourrisse de la vie de tous les jours, Two Holes of Water-3 incorpore des éléments technologiques et sociologiques qui relèvent de la société de consommation : voiture, machine à écrire, projecteur, télévision. Les projections de paysages et d’animaux sauvages semblent évoquer une société où le rapport au monde est conditionné par l’image. Les pauses des danseuses devant un miroir déformant et celles d’une jeune femme filmée simultanément de face et de dos excitent chez le spectateur le narcissisme et le voyeurisme. Pulsions entretenues par une minuscule caméra à fibre optique que Whitman promène le long d’un corps.