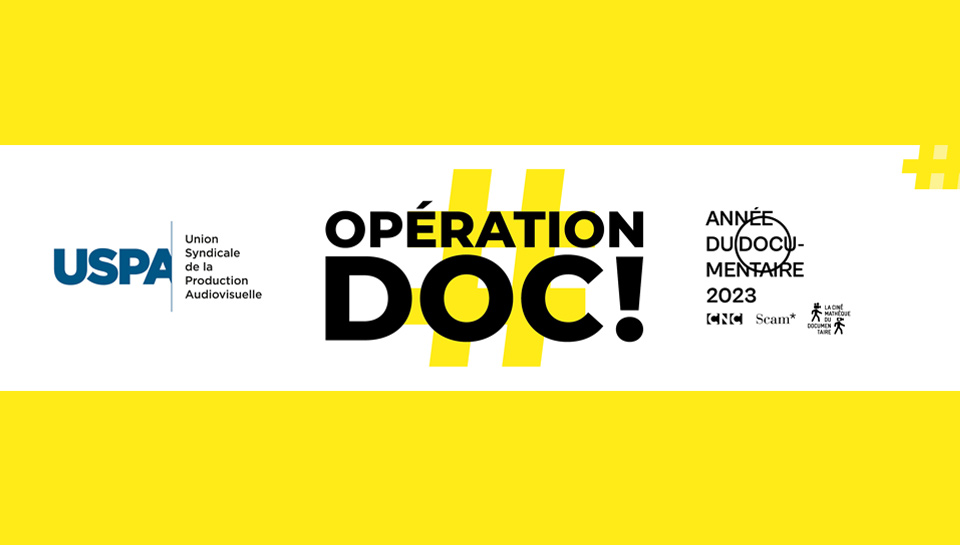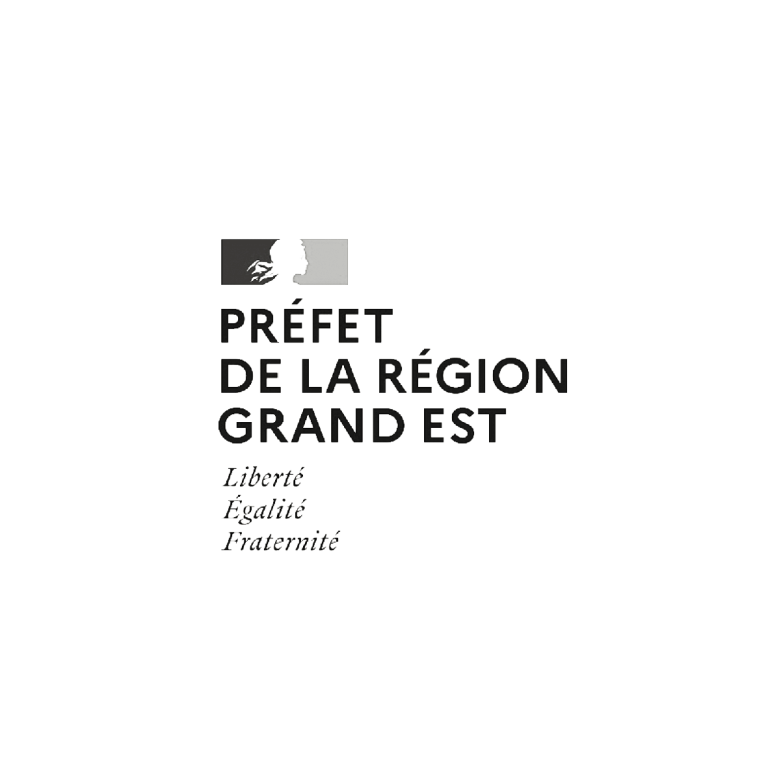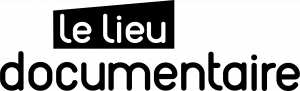Programmer des documentaires : lesquels ? avec qui ? pour qui ? Pour répondre à ces questions, on a pris la direction de Paris pour aller écouter des pros du cinéma documentaire parler de leur expérience. C’était captivant, alors évidemment, on vous raconte.
Retour en deux articles sur trois journées de réflexion :
- Au CNC le 28 novembre sur le thème « Documentaire : quel renouvellement de la création pour quels publics ?« ,
- Au Forum de l’Image pour la journée de lancement de la plateforme « Opération Doc ! » le 5 décembre,
- Au CNC pour le quatrième volet de « Matières à penser« , les cycles de rencontres CNC – Arte – Scam, sur le thème Le documentaire a-t-il un genre? le 8 décembre.
Dans le premier volet de cette série d’articles, on tente de répondre à la question : Comment rendre une programmation plus inclusive ?
Pertinence d'une programmation inclusive - Dans le fond...
Programmer des documentaires, c’est choisir des points de vue sur le monde. La réalisatrice Michèle Dominici affirme en ce sens qu’il est important de « faire voir différents regards » dans le cinéma le documentaire qui a longtemps été entre les mains d’une majorité très uniforme. Elle souligne la nécessité de multiplier les sujets et les points de vue pour refléter la variété du monde.
L’essayiste Camille Froidevaux-Mettrie insiste également sur la nécessité de la représentativité : « Il faut faire entendre ces paroles [qui ont été] silenciées. » Ainsi, il faut inclure l’ensemble des regards, y compris ceux des minorités, des femmes et des personnes qui bénéficient de peu d’espace d’expression.
Océan, réalisateur d’une série documentaire éponyme sur sa transidentité, note l’absence de films sur certains thèmes faits par les personnes concernées et souvent perçus à travers le « cis-gaze ». Le réalisateur rappelle l’importance de diversifier les points de vue sur la transidentité et notamment en termes de nombre de documentaires sur ce thème proposés par les plateformes et à la télévision.
... et dans la forme
Froidevaux-Metterie relève la nécessité d’une représentativité qui se retrouve également au niveau des réalisateur.ices et des diffuseur.ices en alertant sur le risque de reproduire des hiérarchies « où seules quelques-unes parviennent à réaliser des films ». Elle revendique la nécessité d’un cinéma documentaire féministe intersectionnel.
Ce concept d’intersectionnalité, pensé en 1991 par la juriste Kimberlé Williams Crenshaw, met en réflexivité le lien entre différents types d’oppressions qui peuvent s’imbriquer entre elles : le racisme et le sexisme par exemple. Il pousse à reconnaître les mécanismes de domination qui peuvent s’appliquer sur les individu.es de façon complexe et mouvante.
Repenser tout le processus de création et de diffusion des films documentaires répond donc à des enjeux éthiques. Toutefois, mener à bien ces volontés est tributaire de moyens concrets et matériels. Camille Ducellier, artiste et vidéaste, appuie sur les contraintes d’ordre économiques auxquel.les sont confronté.es les femmes et les personnes queer dans le cinéma documentaire :
« On se retrouve dans l’endroit où la pression économique est la moins forte. Il y a des portes ouvertes à certains endroit car fermées à d’autres : à la fois on bénéficie de certains espaces mais il faudrait qu’on nous autorise à aller dans des espaces où il y a plus d’argent, de liberté, de moyens... »
Camille Ducellier
Si ces enjeux semblent très actuels dans un contexte de remise en question de l’industrie cinématographique post #MeToo, les débats sur la représentativité à l’écran et derrière la caméra sont anciens.
Il y a près de 50 ans, en 1976, l’actrice, vidéaste et réalisatrice Delphine Seyrig alertait dans « Sois belle et tais-toi » sur le manque de représentativité des femmes dans le cinéma. Des femmes blanches, noires, hétérosexuelles ou lesbiennes y parlaient de leur rapport au travail en tant que femmes et dénonçaient ce qu’on pourrait aujourd’hui appeler un male gaze ambiant.
L'exposition "Défricheuses - féminismes, caméra au poing et archive en bandoulière" qui s'est déroulée à la Cité Internationale des Arts à Paris du 28 septembre au 20 décembre 2023 avec le Centre Simone de Beauvoir abordait notamment ces enjeux à travers un "dialogue entre générations de vidéastes et artistes féministes"
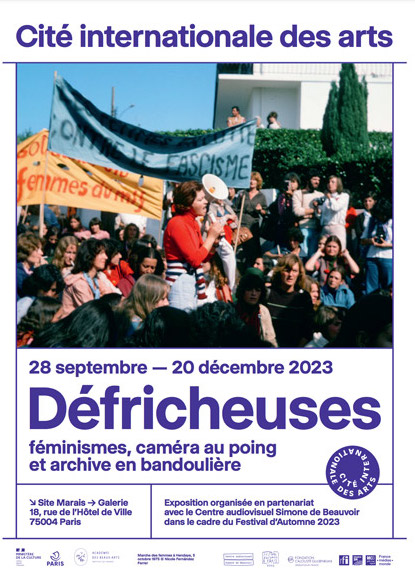
Le centre audiovisuel Simone de Beauvoir est d’ailleurs un lieu de ressource important qui contient un grand nombre de films féministes, queer, militants ou simplement réalisés par des femmes depuis les années 1960. Ils sont consultables sur demande.
Programmation inclusive : quel revers de médaille ?
La catégorisation dans une grille de programmation peut devenir un obstacle à l’inclusivité, comme le souligne Ilana Navaro : « Le danger, c’est qu’on improvise tout le temps des sujets ‘femmes’, mais une fois que la mode sera passée, il n’y en aura plus. » Elle plaide pour l’inclusion du regard féminin et féministe dans les films globaux.
Paul Preciado aussi s’oppose à la catégorisation par identité de genre, préférant se concentrer sur une réflexion concernant la dissidence de la sexualité : « Pour moi, le corps ne définit pas l’identité. Ce qui m’intéresse, c’est de savoir comment les technologies cinématographiques de représentations sont des technologies du genre« .
La réalisatrice Joana Hadjithomas critique également cette catégorisation, soulignant son lien avec une notion de « possession capitaliste ».
Programmer des films féministes et inclusifs c’est bien, mais il peut être réducteur voir dangereux de les enfermer dans une sous-catégorie à part entière.
Les mutations sociologiques du monde nous poussent à s’adapter, surtout dans le cinéma documentaire, pour enrichir nos points de vue, documenter la complexité du monde et faire entendre toutes les voix.

- Jusqu’au 25 janvier 2024, date de fin du FIPADOC, la plateforme Opération Doc! propose une sélection de plus de 45 documentaires qui abordent des thèmes et des enjeux diversifiés : n’hésitez pas à y faire un tour !
Si vous n’êtes pas encore abonné.es à notre newsletter hebdo : ABONNEZ-VOUS en envoyant un mail “Inscription” à lelieu@lelieudocumentaire.fr ou en vous inscrivant directement via la page d’accueil du site.
Un article de Pauline Ancé